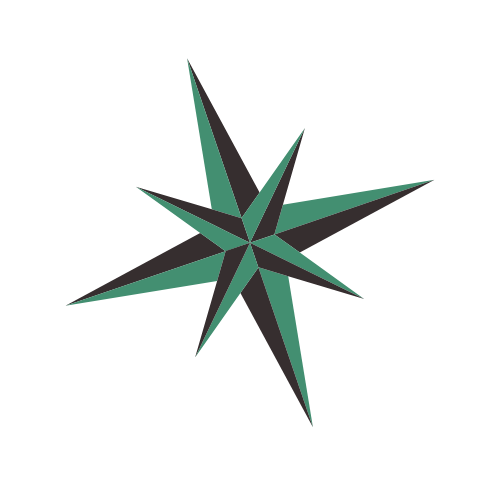Le blason d’Île-de-France
Origine de l’Île-de-France
Premiers habitants
Les premiers êtres humains s’installent dans la région il y a environ 13 000 ans, notamment autour d’Étiolles. Cependant, ce n’est qu’à l’époque gauloise que des agglomérations commencent à émerger. À cette époque, quatre tribus se partagent le territoire de la future Île-de-France : les Parisii au centre, les Véliocasses au nord, les Carnutes à l’ouest et les Sénons au sud-est, créant Sens. Le royaume capétien émerge à partir de Soissons, ville dominante établie par les Celtes, mais le blason d’Île-de-France n’est pas encore créé.
Époque romaine
La prospérité de la région attire l’attention des peuples voisins, notamment les Romains, qui cherchent à venger le saccage gaulois survenu en 390 avant J-C. Ils commencent à envahir la Gaule au IIe siècle avant J-C, tandis que les Francs arrivent par le nord. Sous la direction de Jules César, la Gaule devient complètement gallo-romaine en l’espace de soixante-dix ans. Sur les dix millions de Gaulois, environ cinq cent mille sont tués et autant sont réduits en esclavage à Rome. Pendant plus de quatre cents ans, les Romains organisent le territoire en construisant des routes et des villes, telles que Lutèce, Amiens, Cluny, Bordeaux et Lyon. L’aire géographique se structure sous l’influence du latin et du droit romain.
Repoussés aux IIIe et IVe siècles par les Romains, les Francs obtiennent, grâce à Aetius au début du Ve siècle, le droit de s’établir dans la région au nord de la Seine. En 432, ils choisissent Tournai comme leur capitale. Clovis y est couronné roi des Francs en 486, mais décide de faire de Paris la capitale de son royaume, intégrant ainsi une partie du nom de ce futur royaume.
Un empire avant un royaume
L’empire romain s’effondre avec la destruction de Rome par les Barbares. Clovis en profite pour étendre son royaume, dont les limites commencent à se dessiner entre la Loire et le Rhin. En 511, l’empire franc est scindé en cinq royaumes – Soissons, Reims, Orléans, Lutèce et Burgondes – chacun dirigé par un fils de Clovis. Les guerres et les héritages redéfinissent encore le territoire franc pendant des siècles.
Les Francs jouent un rôle crucial dans l’unification du pays en y établissant le christianisme, relayé par des évêchés érigés dans chaque royaume. Childebert II émet la première loi déclarant le dimanche jour férié en 595.
En 751, Pépin le Bref est couronné roi des Francs. Avec son fils Charlemagne, il s’emploie à étendre l’empire carolingien, délaissant Paris comme capitale.
Les Vikings, effectuant des incursions le long des côtes de la Manche pendant soixante-dix ans, poussent le roi à fortifier les rives de la Seine et de l’Epte tout en élargissant les frontières à l’est et au sud. Aix-la-Chapelle est alors choisie comme capitale de l’empire. En 800, Charlemagne est couronné empereur d’Occident à Noyon, tandis que son frère Carloman, couronné à Soissons, dirige l’empire oriental. Les Carolingiens installent un palais impérial à Clichy, entre Paris et Saint-Denis.
Après le décès de Charlemagne, les comtes et vassaux réussissent à rendre leurs fonctions héréditaires. Trois vagues d’invasions – Musulmans, Vikings et Hongrois – légitiment leur statut d’hommes de pouvoir. C’est ainsi que se met en place une société féodale, divisée en trois ordres : le clergé, la noblesse et le Tiers-État.
Émergence du domaine royal
Les Normands, après avoir rejoint le roi d’Angleterre, sont finalement cédés par Charles le Simple en 911 au duc de Bourgogne, en échange de la paix, incluant le comté de Rouen et tout le territoire entre l’Epte et la mer. Cette concession leur fait perdre le Vexin français. L’espace central, entouré de plusieurs rivières, commence à avoir l’apparence d’une île, englobant le Noyonnais, le Laonnois, le Soissonnais, le Valois, le Parisis et le Hurepoix.
En 987, avec la mort du dernier carolingien Louis V, sans héritier, Hugues Capet, duc des Francs depuis 960, est élu roi des Francs après avoir soumis les grands vassaux. Il instaure la monarchie héréditaire pour garantir le règne des Capétiens, et Paris redevient la capitale du royaume. La « Francie » est délimitée au nord-est par les rivières Escaut, Meuse, Saône et Rhône, au sud par les Pyrénées, y compris le comté de Barcelone. Toutefois, le domaine royal concerne principalement Orléans, Poissy, Senlis et Attigny. Le reste des terres est scindé en principautés, notamment des comtés (Flandres, Vermandois, Anjou, Toulouse et Barcelone) et des duchés (Bretagne, Normandie, Bourgogne, Aquitaine et Gascogne), ainsi que le marquisat de Gothie.
Vers 1030, le pays subit une restructuration visant à réduire le pouvoir des grands duchés. À partir de 1150, la maison Plantagenêt prend de l’ampleur alors que le pouvoir royal continue d’étendre son domaine. Au début du XIIIe siècle, Philippe Auguste parvient à conquérir la majorité des possessions des Plantagenêt, grandissant considérablement le domaine royal et diminuant la menace anglaise. Il établit le centre administratif du royaume à Paris.
Conflits et unions durant la guerre de Cent Ans
Les grands seigneurs se rallient à Louis IX (Saint-Louis) pour prendre part aux croisades en Terre sainte. À cette période, le blason d’Île-de-France apparaît, orné de fleurs de lys représentant le royaume. Après la mort de Saint-Louis, les disputes de succession plongent le pays dans la guerre de Cent Ans, aggravées par la peste noire dès 1347 et les révoltes paysannes causées par des famines. Rapidement, la France perd la moitié ouest de ses possessions aux mains du royaume d’Angleterre.
La reconquête débute en 1364, sous Charles V, assisté par Du Guesclin. Charles VI, souffrant de démence, ne peut malheureusement pas continuer le travail de son père après 1380. Louis d’Orléans, leader des Armagnacs, et Jean sans Peur, duc de Bourgogne, rivalisent déjà pour le trône. Cependant, en 1415, alors qu’Henri V d’Angleterre s’autoproclame roi de France, les rivaux décident de s’unir pour combattre leur ennemi commun.
Lors de l’attaque, les Bourguignons se retirent, laissant les troupes françaises subir un massacre à Azincourt. Dès lors, les Armagnacs s’engagent dans une guerre civile contre les Bourguignons, tandis que les Anglais avancent vers Paris. Henri V épouse la fille de Charles VI, devenant ainsi l’héritier officiel du trône français.
En 1428, les Anglais reprennent les armes et occupent Orléans. Le dauphin Charles VII se trouve dans une position fragile, en attente d’un miracle pour prouver sa légitimité. En 1429, Jeanne d’Arc, la Pucelle de Lorraine, lui propose de libérer Orléans. Victorieuse et soutenue par Charles VII, elle s’empare ensuite de Reims, territoire bourguignon. Cependant, après son couronnement à Reims, le roi l’abandonne lors de sa tentative de reprendre Paris.
Capturée à Compiègne en 1430, le roi, qui préfère préserver le clergé, la livre à l’évêque de Beauvais, proche des Bourguignons. Jeanne est brûlée vive à Rouen par les Anglais en 1431. Ainsi, le peuple se soulève contre les occupants anglais et non contre Charles VII, facilitant ainsi la reconquête du pays en sa faveur.
La reconnaissance de l’Île-de-France
Un traité déterminant
Le traité d’Arras de 1435 pose les bases de la province telle qu’elle existe jusqu’à la Révolution. Le roi cède au duc de Bourgogne le Laonnois (Laon), le Noyonnais (Noyon), le Soissonnais (Soissons, Braisne, Coucy), le Valois (Senlis, Crépy, Villers-Cotterêts) et le Beauvaisis (Beauvais, Beaumont, Creil), qui relèvent désormais de la Picardie. L’Île-de-France restante comprend le Vexin français (Pontoise, Magny, Chars), le Mantois (Mantes, Meulan, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye), le Hurepoix (Dourdan, Corbeil, Longjumeau, Sceaux), le Gâtinais français (Nemours, Fontainebleau, Moret) et la Brie française (Brie-Comte-Robert, Lagny, Nangis, Villeneuve-Saint-Georges).
Les comtés de Dreux et de Montfort y sont intégrés plus tard. Concernant la Brie, l’ordonnance royale du 27 septembre 1693 met fin aux conflits entre l’Île-de-France et la Champagne, menant à sa division en Brie française et Brie champenoise (incluant Coulommiers, Château-Thierry et Montereau).
Charles VII désigne le comte de Clermont comme gouverneur de la province. Tandis que le centre administratif demeure en Île-de-France, Charles VII et sa cour se déplacent à Chinon, et son successeur, Louis XI, opte pour Loches. Après avoir chassé les Anglais, il repousse les Bourguignons de son royaume jusqu’en 1477.
Ce conflit a permis l’établissement d’un système étatique centralisé à Paris, avec des parlements régionaux pour administrer la justice et gérer les affaires locales. Progressivement, les principautés disparaissent en reconnaissant la souveraineté du roi de France. Cette organisation perdure jusqu’à Louis XII et François Ier, lesquels sont alors installés à Blois. François Ier, en effet, choisit de ramener la cour à Paris, sélectionnant Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye, jugés plus sains que le Louvre.
Province et généralité
La province ainsi établie se dote d’une généralité de Paris, divisée en élections : Senlis, Compiègne, Beauvais, Pontoise, Mantes, Montfort, Dreux, Étampes, Melun et Nemours. L’intendant de cette généralité est sous l’autorité du gouverneur.
Jusqu’au XVIe siècle, le gouvernement de Paris est associé à celui de l’Île-de-France. Cependant, sous Henri IV, ils sont séparés ; Soissons devient le siège militaire du gouvernement de l’Île-de-France, tandis que Paris conserve un gouvernement distinct.
Consolidation du pouvoir central et industrialisation
À l’époque de Louis XIV, la monarchie renforce son autorité en instaurant une administration centralisée. La cour quitte Paris pour Versailles, tandis que l’hôtel de ville, créé en 1533, reste à Paris, où la place Dauphine est achevée en 1607. Le Nôtre aménage la Grand Cour du Louvre, qui, en 1707, devient les Champs Élysées. Pour soutenir les nombreux projets de construction du roi, les manufactures se développent à Paris, Meaux, Saint-Maur, Corbeil, Antony, etc. Simultanément, de nombreux habitants émigrent vers la nouvelle France (Québec).
Au début de la Révolution, les élections aux États Généraux révèlent clairement les tensions politiques entre Paris et ses banlieues, souvent en retrait d’une Révolution profondément parisienne. La question d’un découpage administratif se pose rapidement.
En 1790, les commissaires de l’Assemblée constituante décident que le territoire de l’Île-de-France peut être divisé en cinq départements : la Seine, incluant Paris (dans un rayon de trois kilomètres autour de Notre-Dame), s’étirant vers le sud et l’ouest, la Seine et Oise au nord, l’Oise et l’Aisne au-dessus. La Seine-et-Marne, à l’est, est à l’époque encore exclue de l’Île-de-France ; elle ne sera intégrée que 175 ans plus tard.
Cette division, ratifiée par l’Assemblée, correspond approximativement à l’étendue de la province, sauf pour la partie nord du département de l’Aisne, dont Saint-Quentin est le centre, qui est picarde sans contestation.
Développement de l’Île-de-France
Rayonnement international
La centralisation administrative s’intensifie sous Napoléon, désireux de faire de Paris la capitale de l’Europe. Les fonctions de préfet de la Seine et de préfet de la police sont mises en place. Dès 1830, l’essor industriel tire profit de la mise en place de voies ferrées reliant Paris et ses environs. En 1848, le train parvient à Orléans, Rouen et Lille. Ce sont alors le début des grands travaux du baron Haussmann, préfet de la Seine ; pour élargir les rues et rendre les quartiers plus sains, la population est progressivement relocalisée en périphérie de Paris de 1853 à 1870, tandis que des usines s’installent dans les banlieues pour employer cette nouvelle main-d’œuvre. De nouveaux foyers émergent et la démographie explose.
Inégalités entre la capitale et le reste de la région
Malgré l’existence officielle de la province depuis 1435, des disparités profondes traversent la population francilienne marquée par une histoire tumultueuse. Vers 1850, les paysans de Maisons-Laffitte désignent encore le vent venant de l’est comme le « vent de France », tandis que ceux de Trilport, près de Meaux, expriment qu’ils ne vont « en France » qu’en franchissant la Marne vers le nord-ouest.
La structuration sociale de la province n’arrange pas la situation. Les efforts d’amélioration urbaine continuent de se concentrer sur Paris, apportant d’importants bénéfices aux Expositions universelles de 1889 et 1900, mettant ainsi en lumière la capitale à l’échelle internationale. Ainsi, le métro s’ajoute rapidement au tramway pour faciliter le transport des habitants. Néanmoins, l’unité linguistique tarde à émerger, malgré l’enseignement du français à l’école. À la fin du XIXe siècle, le parler d’Île-de-France se caractérise par certaines spécificités par rapport aux autres dialectes, notamment dans la Brie et le Gâtinais. Le patois ou argot de Paris et de ses environs est également très distinctif.
Sources : Fernand Bournon, Benjamin Guérard (Du nom de France et des différents pays auxquels il fut appliqué, 1849) et A. Longnon (L’Île-de-France, son origine, ses limites, ses gouverneurs)
Industrialisation et urbanisation
Durant la Première Guerre mondiale, l’Île-de-France est fortement impliquée dans le conflit, soutenant les troupes du front grâce aux taxis de la Marne. C’est également en Île-de-France que sont signés les traités de paix : à Versailles, au Trianon, à Sèvres et à Saint-Germain. Malgré ces événements, l’industrialisation continue, renforcée par le relais du ferroviaire et la renommée de la capitale.
Pour accompagner l’essor urbain d’après-guerre, lié à l’industrialisation des banlieues, la question de l’aménagement du territoire émerge. Ainsi, la banlieue s’étend progressivement avec l’apparition de lotissements et de zones pavillonnaires.
Si de grandes grèves éclatent dans le nord, dans les mines de charbon, les ouvriers d’Île-de-France revendiquent de meilleures conditions de travail, conduisant à la naissance de parties politiques socialistes qui se développent rapidement. En 1936, la Force ouvrière parvient à faire adopter le droit aux congés payés.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le pouvoir central se réfugie à Vichy face à l’avancée allemande. Rapidement, les divisions entre divers partis politiques se creusent concernant la position du chef de la nation face à l’envahisseur. Les partis ouvriers sont les premiers à organiser la résistance, avant d’être rejoints par d’autres acteurs de toute tendance. Ensemble, ils mettent en place des groupes paramilitaires souhaitant l’unification pour former un mouvement national. La libération de Paris devient un symbole de celle de la France : « Paris martyrisé, mais Paris libéré » – Général de Gaulle.
Dès le début des années 1950, il a été engagé de vastes travaux de reconstruction, amplifiés par la désertification des zones rurales. De grands ensembles sont alors édifiés autour de Paris, modifiant progressivement les villages et le paysage agricole aux alentours de la capitale.