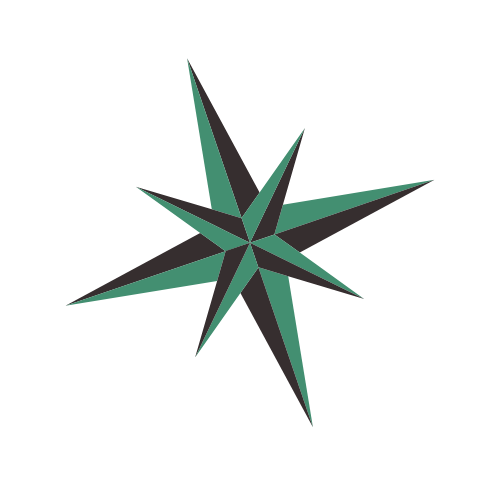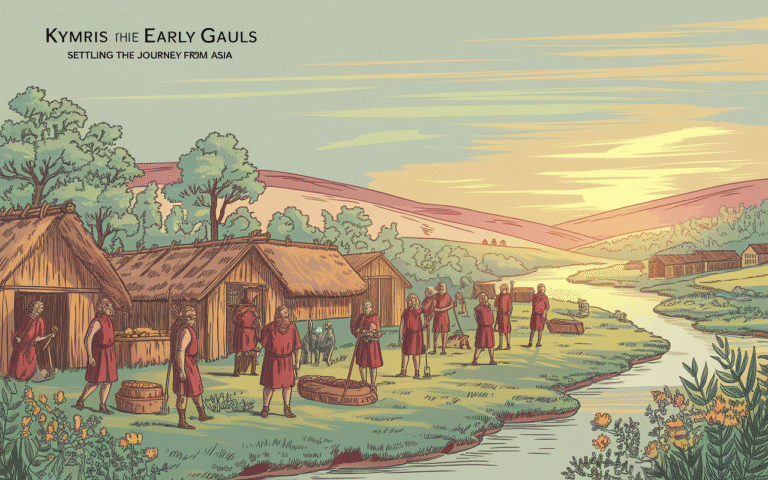Le Gâtinais, ancien comté
Introduction au Gâtinais
Origines et premiers habitants
Dans la préhistoire, le Gâtinais était une partie du territoire sénon établi par les Romains, situé entre les Carnutes (Chartres) à l’ouest et les Lingons (Langres) à l’est. Cette région était principalement couverte de forêts. Sa capitale, Château-Landon, construite sur un promontoire rocheux le long d’une voie romaine, a été assaillie par les Romains en route vers Orléans pour réprimer une rébellion gauloise en 52 avant notre ère.
Au 4ème siècle, dans le cadre de réformes menées par les Francs en Gaule, le diocèse de Sens prend en charge les cités d’Auxerre, Chartres, Meaux, Troyes, Orléans et Paris, ce qui conduit à la création de l’archidiocèse de Sens. Paris, quant à elle, n’acquerra le statut d’archevêché qu’en 1622, plaçant les cités de Chartres, Meaux et Orléans sous cette autorité. Sens se divise ensuite en plusieurs « pagi ou païs », incluant le pays de Sens, Melun, Provins, Etampes et Gâtinais.
Formation du comté du Gâtinais
Entre le 5ème et le 6ème siècle, le Gâtinais est envahi et ravagé par les Bagaudes, les Germains et les Huns, d’ailleurs son nom signifie littéralement « pays dévasté ». Reconnu dès le 6ème siècle, il s’étendait autour du bassin du Loing et de ses affluents, allant de Châtillon-Coligny à l’est jusqu’à Boiscommun au sud, de Milly à l’ouest, et de Montereau au nord. Suite à ces invasions, le Gâtinais évolue pour devenir un comté, tandis qu’Étampes et Nemours deviennent duchés, et Rochefort, un comté.
Vers 515, l’abbaye bénédictine St-Colomban est fondée à Ferrières, mentionnée au début du 7ème siècle. Clovis accorde également à Château-Landon le droit de construire l’abbaye St-Séverin, dont la prospérité est rapidement assurée grâce aux compétences des moines. Cela attire rois, comtes et abbés qui se partagent ses privilèges. C’est dans ce contexte qu’en 1043 naît Foulques de Réchin, petit-fils de Foulques de Nerra, comte d’Anjou. Cependant, les limites géographiques du Gâtinais demeurent incertaines, chaque « chrétienté » négociant ses propriétés, incluant celle de Gâtinais, Ferrières et Milly.
Subdivision du Gâtinais
En 1069, Foulques le Réchin cède son comté au roi Philippe Ier, qui l’intègre immédiatement à son domaine, le reliant ainsi à la Brie et à la Beauce orléanaise. En 1168, le comte Robert III Clément devient le gouverneur du jeune roi Philippe II, surnommé Philippe-Auguste.
En 1204, au moment où les forces anglaises et françaises s’affrontent en Normandie, Anjou et Touraine, le comte Henri Clément reçoit le château d’Argentan (appartenant auparavant aux Plantagenêt) en 1207 pour ses succès militaires, ainsi que le château de Parthenay en 1208. Sous Philippe-Auguste, les frontières du Gâtinais sont étendues au-delà de la forêt d’Orléans. Jean, son fils, devenu maréchal en 1225, finance également les vitraux de la cathédrale de Chartres. À la suite d’échanges et de ventes entre seigneurs et religieux, le territoire se divise en deux : le bailliage d’Orléans à l’ouest et celui de Sens à l’est. Cependant, le Gâtinais recule jusqu’à la Loire, le comté étant transféré à Itiers du Mez en 1258. En 1314, ses héritiers le vendent à Philippe le Bel et en 1329, il passe sous la coupe de Philippe de Valois.
Le Gâtinais et la guerre de Cent Ans
Conflits et épidémies
La guerre commence en 1337 lorsque Aliénor d’Aquitaine, ancienne épouse de Louis VII, réclame des biens dans le royaume de France après avoir épousé Henri de Plantagenêt. Philippe de Valois lui confisque la Guyenne, déclenchant une guerre avec l’Angleterre. Après avoir envahi la Normandie, les Anglais encerclent la France par l’ouest et le sud, capturant les seigneuries fidèles aux Valois. La peste noire, apparue en 1348, freine leur avancée tout en causant de nombreuses pertes humaines.
En 1350, Jean le Bon, fils de Philippe de Valois, défend le royaume tout en combattant les attaques de son cousin Charles le Mauvais, roi de Navarre, qui incendie le duché de Nemours en 1358. Malheureusement, Jean est capturé lors de la bataille de Poitiers. Après une brève libération en 1360, au cours de laquelle il établit le « franc », il meurt prisonnier en 1364.
Pillages et résistance
Son fils Charles V, surnommé le Sage, monte sur le trône et restaure les finances du royaume en instaurant un impôt sur le sel, la gabelle. Il réorganise également l’armée avec des milices permanentes. En 1370, Bertrand du Guesclin, un chef breton, devient connétable de France et commence à reconquérir le territoire. Après avoir repris l’Aquitaine, le Poitou et la Normandie, il meurt au siège de Châteauneuf de Randon en Auvergne en 1380.
Peu après, le roi décède, laissant le royaume à Charles VI, qui est trop jeune et souffre de troubles mentaux, entraînant un affaiblissement du pouvoir royal. En 1390, 20 000 pillards traversent le Gâtinais pour rejoindre Paris, dévastant Milly et Étampes en cours de route.
En 1404, le Gâtinais est de nouveau divisé horizontalement, la partie nord intégrant le duché de Nemours, lié à la généralité de l’Île-de-France, et est alors désigné comme le Gâtinais français, donné au roi de Navarre. Cette région s’étend jusqu’à Corbeil en passant par Melun, et à l’est jusqu’à Courtenay et l’Yonne. Montargis, relevant de la généralité d’Orléans, devient la capitale du Gâtinais orléanais, englobant tout le plateau de Pithiviers jusqu’à Janville et Neuville. Malgré cette expansion du Gâtinais, Sens perd du pouvoir et la région continue de subir les attaques des Orléanais, Savoyards, Bourguignons et Armagnacs.
La résistance héroïque de Montargis
Malgré l’hostilité ambiante, Montargis résiste aux assauts des pillards. En 1427, les troupes de Lord Warwick échouent à prendre la ville, défendue par le capitaine gascon Bouzon de la Faille. Bien que désespéré, ce dernier sollicite des vivres auprès du connétable Richemond, qui ne peut aider financièrement. Il finit par vendre sa couronne de comte pour lever des fonds et recruter l’armée du Bâtard d’Orléans, le comte de Dunois.
Après trois mois de sièges, où famine et maladie sévissent, les habitants sont enfin secourus par l’armée de Dunois et La Hire. Avec leurs 1600 hommes, ils parviennent à repousser les Anglais, mettant ainsi un terme à cette première défaite pour l’armada anglaise. En reconnaissance de leur bravoure, le roi Charles VII libère Montargis de tous les droits, sauf la gabelle, et permet aux habitants d’utiliser le bois local pour se chauffer, ainsi que l’organisation de quatre foires annuelles pour stimuler l’économie locale. L’intervention de Jeanne d’Arc en 1428 renverse la situation : les forces françaises libèrent des villes comme Nemours, Sens, Melun, Moret, Château-Landon et Montereau, mais le Gâtinais reste considérablement dévasté et ruiné.
La lutte pour redresser le Gâtinais
Un regain d’espoir
Au 16ème siècle, le Gâtinais se tourne vers la production de noix et de safran pour redresser son économie, connaissant un succès significatif. Boynes émerge comme la capitale française du safran, séduisant même des acheteurs d’Allemagne et de Hollande lors de sa foire de novembre.
Une période difficile
A partir du 17ème siècle, le marché est accaparé par les marchands de Pithiviers, et la foire de Boynes s’éteint. La situation se dégrade en 1652, durant la Fronde, lorsque le siège d’Étampes par le vicomte de Turenne laisse derrière lui de nombreux corps, attirant prédateurs et charognards. À la tragédie s’ajoutent morts des épidémies de typhus, rendant les cimetières incapables d’absorber la mortalité. Les loups, capables de trouver de la chair humaine entre Fontainebleau et Hurepoix, commencent à attaquer les plus faibles. La peur envahit la population avec des annonces de 300 victimes, entraînant une extermination des loups. En 1663, un hiver particulièrement rigoureux cause la famine, laissant 20% de la population décéder sans possibilité de blâmer les loups.
Le Gâtinais connaît encore des ajustements territoriaux, avec le retrait de Milly, Janville, Neuville et Vitry qui sont remis à l’Île-de-France. En 1698, Louis XIV officialise la culture du safran.
En 1709, la région endure un hiver glacial, où les températures plongent à -20°C. Des rations de riz sont distribuées pour éviter une crise de famine.
Réorganisation du Gâtinais
En 1785, Louis-Philippe-Joseph, duc d’Orléans, succède à son père et hérite de la forteresse de Montargis, à peine habitée. Mais un nouvel espoir d’économie émerge avec une filature de coton avant que la Révolution ne mette fin à cet élan, для forcing les héritiers à vendre leurs biens. Les limites du Gâtinais sont à nouveau rediscutées, avec la partie française intégrant des communes de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise. Le Gâtinais orléanais est entièrement absorbé par le Loiret.
En 1802, l’arrondissement de Montargis perd potentiellement des territoires erronément inclus dans le val de Loire et la Beauce, récupérant ses origines au sein du Loiret. Les deux régions du Gâtinais continueront à exister séparément, chacune conservant ses spécificités.
En 1809, un spéculateur acquiert le vieux château de Montargis pour vendre les pierres et autres matériaux locaux. Heureusement, en 1837, une église évangélique prend possession des lieux, empêchant la destruction des derniers vestiges de la forteresse. Le château reste au repos durant près de 50 ans, avec plusieurs propriétaires successifs. Après les hivers rigoureux de 1880 et 1881, la production de safran s’effondre en raison du gel des bulbes.
Au 20ème siècle, le dernier producteur de safran cesse ses activités en 1930, car il devient trop coûteux face aux colorants et parfums synthétiques. L’école St-Louis s’installe dans l’ancien château de Montargis, préservant ainsi une partie du patrimoine.
Le Gâtinais aujourd’hui
Comme dans d’autres régions, une portion du Gâtinais est protégée au sein d’un parc naturel régional. Cela concerne le Gâtinais français, qui regroupe actuellement 69 communes. Le bocage orléanais et les cultures beauceronnes restent ancrés dans le Gâtinais orléanais.
Le parc, dû à ses sols riches en sable et en grès, est également connu sous le nom de pays des mille clairières et du grès. Trois rivières traversent le territoire : la Juine, l’Essonne et l’École, ainsi qu’un fleuve, la Seine au nord-est. Ces capacités de la terre favorisent la production de plantes médicinales, d’orge brassicole et de miels forestiers.
Le Gâtinais s’illustre aussi par la pratique de la varappe sur ses chaos gréseux et dans la construction de pierre de taille. Sa diversité de paysages, sa faune et sa flore en font un territoire à explorer, bien que sa fragilité nécessite une attention particulière de la part des visiteurs soucieux de préserver son authenticité.